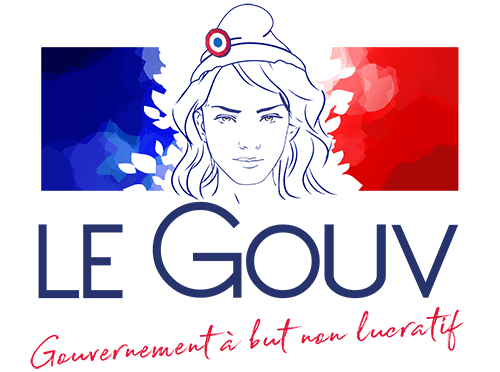Ministère de la Culture et du Patrimoine du Gouv
L’originalité profonde, historiquement, du mouvement des gilets jaunes, aura été de porter sur la forme de la démocratie avant de discuter d’un quelconque contenu : de manière que j’espère prémonitoire, en appeler à l’écriture populaire d’une nouvelle constitution. Au fond, « crise du COVID » oblige, tel est plus que jamais l’enjeu, dont les Gilets jaunes auront été les Cassandre collectifs (maintenant, à mon humble avis, c’est le paradigme d’Antigone qui s’impose, dans les arts comme ailleurs, mais j’y reviens bien sûr). Cela n’implique rien de moins, à mes yeux, que le renversement de l’actuel gouvernement, et la destitution de l’actuel président de la République (ce que demandaient déjà, avec leur sens habituel de la prémonition, les Gilets jaunes). C’est pourquoi des gens de tous bords politiques ont appris, dans le cadre de cet immense mouvement, à se parler : nous étions, avant la fameuse « crise du COVID », dans une situation d’urgence ; nous y sommes plus que jamais. Dans la novlangue officielle, « état d’urgence » est une litote pour désigner ce qu’on appelle plus crûment, en philosophie politique, un état d’exception.
Or c’est de ce point, et uniquement de lui, qu’il faut partir.
La démocratie libérale telle que l’Occident a pu la connaître depuis plus de deux siècles est désormais morte, et aucun service de réanimation ne pourra la ressusciter. Nous sommes entrés dans des régimes dictatoriaux de type entièrement nouveaux aux contours encore mal définis. Les totalitarismes divers du vingtième siècle étaient tout sauf des accidents ; voilà ce que révèle la soi-disant « crise sanitaire » au nom de laquelle on a décrété un peu partout dans le monde l’état d’exception. Le grand philosophe prémonitoire de tout ce qui est en train de nous arriver est l’italien Georgio Agamben, qui avait prévu il y avait déjà 25ans dans son livre-phare, Homo sacer, que démocraties et dictatures risquaient d’entrer dans une zone d’indiscernabilité sans retour. Nous y sommes. Je cite un petit extrait de son livre, pour les bonnes bouches : « La décision souveraine sur la vie nue abandonne des motivations et des sphères strictement politiques pour se déplacer sur un terrain plus ambigu où le médecin et le souverain semblent échanger leurs rôles. » En clair : dès que vous mettez des « médecins » au pouvoir, le fascisme n’est pas très loin. C’est sur cette situation cruciale qu’il faut nous arrêter d’urgence, avant de parler de quelque « politique culturelle » que ce soit, dans un monde où, au nom de la « santé », on interdit les concerts, les théâtres, les cinémas, les écrivains libres, les artistes libres, les réunions publiques libres, pour ne rien dire du reste. Sacré « COVID » ! Tu nous as servi de prétexte à interdire tout type de lien social qui ne soit pas numérisé.
LA DIALECTIQUE SUBTILE DE LA TRANSGRESSION ET DE LA CONSERVATION
C’est donc de là qu’il faut partir : fidèle à l’impulsion des gilets jaunes, la politique culturelle du Gouv doit être celle d’une « révolution conservatrice » de type nouveau : oui aux concerts ; oui aux théâtres ; oui aux cinémas ; oui aux artistes et écrivains LIBRES. Hélas, hélas : c’est déjà trop tard. L’état d’exception nouveau à quoi nous assistons a déjà étendu son emprise absolument partout. Il nous faut à présent chercher ailleurs et autrement. Par exemple : qu’est-ce qu’il y avait de bien dans les bonnes vieilles réunions populaires-artistiques ? Réponse précoce d’Aristote : la catharsis, qu’on traduit dans notre idiome moderne par : « défoulement ». C’est au fond la seule « politique culturelle » que je propose : ce que j’appellerai aussi, en entrant dans le détail, la transgression.
Arrêtons-nous donc sur le régime néo-totalitaire actuel. Agamben appelle, dans le sillage de Foucault, « biopolitique » un régime gouvernemental de décision directe sur la vie nue des citoyens : sur leur corps biologique simple. Là encore, nous y sommes à plein. Jusqu’ici, les régimes politiques à avoir poussé cette logique jusqu’à sa dernière extrémité furent les régimes fascistes, et notamment national-socialiste ; c’est à présent presque partout que les gouvernements appliquent leur pouvoir de décision directement sur la vie nue des citoyens. Une « politique culturelle » qui, aujourd’hui, feindrait de ne pas tenir compte de ce fait serait, bien sûr, nulle et non avenue. Ce qui peut nous entraîner très loin. Et ce qui doit nous entraîner très loin, peut-être plus loin que ne seront jamais allés les plus prophétiques de nos artistes depuis plus de deux siècles. Par exemple, nombre d’entre eux nous ont dit : l’art doit devenir la vie. Je crois ce message – « révolution conservatrice », j’y reviendrai – plus que jamais d’actualité.
Or, à quoi avons-nous assisté, pour nous en tenir à la France, depuis un an ? À l’emprisonnement de toute une population au nom d’une maladie qui tuait 0,05% d’icelle, dont la moyenne d’âge était 82 ans, souvent des sujets perclus de comorbidités qui seraient morts de toute façon quelques mois plus tard. On a enterré tous nos droits constitutionnels ou presque ; presque mis hors-service l’état de droit ; euthanasié la quasi-totalité de nos libertés individuelles ; psychiatrisé la liberté d’expression (enfin là, je suis juste un peu prémonitoire ; la postérité me comprendra).
On a sacrifié, au nom de cette maladie-qui-tue-0,05%-de-la-population, les jeunes et les étudiants, les artistes et les restaurateurs, les pauvres et les petits commerçants : on les a poussés à la misère, à la dépression, au suicide. On a martyrisé, de sang-froid, des millions d’enfants : on voit désormais des tentatives de suicide à l’âge de six ans : tel est le prix à payer, nous dit tranquillement le gouvernement, de la « sécurité sanitaire ».
Le même gouvernement a promis d’ouvrir des milliers de lits de réanimation ; il en a en réalité fermé des centaines, et acheté dans le même temps 170000 munitions de LBD dont tous les Gilets jaunes mutilés et estropiés se souviennent (ce qui signifie ce qu’Agamben avait fort bien établi aussi : nous sommes en état, et sans doute à échelle mondiale, de guerre civile plus ou moins larvée ; j’y reviendrai aussi). On a empêché les médecins de prescrire, c’est-à-dire de soigner et guérir ; on a censuré et persécuté tous les scientifiques intègres, et poussé au pouvoir et dans les devantures médiatiques les scientifiques les plus corrompus et perclus de conflits d’intérêts ; on a falsifié les chiffres, les statistiques, les courbes de mortalité ; on est allé jusqu’à falsifier la mort elle-même en estampillant « COVID » des décès qui n’en ressortissaient pas.
On s’est évertué à imposer confinements et couvre-feux à la population, alors même que toutes les études menées à ce sujet prouvaient que de telles mesures ne servaient rigoureusement à rien. Sinon, à mon humble avis, à contenir la guerre civile comme notamment en Grèce, confinée contre toute raison depuis quatre mois et demi : mieux vaut que le peuple se jette dans la Méditerranée que le voir sortir de l’Europe. Un ami qui habite à Athènes m’a fait part d’un nouveau phénomène terrifiant : le suicide instantané, c’est-à-dire sans aucune préméditation apparente. En gros, vous plaisantez avec vos amis, et, dans la seconde d’après, vous vous jetez par la fenêtre. C’est de cette situation, au sens fort du terme (je dirai lequel), qu’il faut partir pour parler d’une « politique culturelle » ajustée au moment où nous sommes.
On a signé des contrats avec des firmes pharmaceutiques pour des « vaccins » indignes de cette appellation, aux clauses à moitié caviardées aux yeux du grand public, et pourtant pas assez pour que nous ne sachions pas que les laboratoires créateurs de ces « vaccins » se dégageaient de tout effet secondaire, dont la responsabilité est donc portée par les États, aux frais du contribuable. Des États qui auront, dès lors, tout intérêt à dissimuler sinon à sous-estimer le nombre de morts, d’effets secondaires graves, de maladies, peut-être de déformations irréparables, qui s’ensuivraient de tels « vaccins ».
On a, un peu en amont de tout ça (et comme conséquence directe de l’insurrection des Gilets jaunes), fait passer toutes sortes de réformes (« sécurité globale ») qui transforment la police en autant d’essaims de milices privées qui, au train où vont les choses, auront à peu près tous les droits sur ce qui reste de notre « citoyenneté » (à peu près rien). En sorte que j’espère que tout le monde a bien conscience du fait que, en matière de « politique culturelle » comme du reste, nous ne pouvons agir que sur ce « peu » qu’il nous reste ; pour pas longtemps, si nous laissons faire. J’ai connu la Tunisie de Ben Ali ; eh bien, je ne crains pas de dire que la France actuelle est pire que ce régime-là. Le nom le plus approprié que je puisse trouve pour qualifier le régime qui s’est mis en place sous l’investiture de Macron est celui de fascisme oligarchique.
« Théorie du complot », me dira-t-on. Je plaide coupable : j’ai publié, en 2015, un livre assez prémonitoire inspiré d’une conférence qui a fait pleurer des dizaines de gens (la catharsis…), intitulé : Artaud et la théorie du complot. Si j’étais un « ministre de la Culture » à l’ancienne, j’imposerais toutes affaires cessantes la lecture de ce texte. Hélas, j’ai été élevé dans la culture « démocratique ». J’ai été bercé d’illusions à ce sujet comme nous tous, comme les Gilets jaunes l’ont brandi à la face du monde entier.
La première fois que j’ai rencontré Jean-Pierre Crépin et Fabrice Grimal pour parler du Gouv, je leur ai dit : « je suis complotiste, tendance Debord. » Voici les raisonnements de ce dernier à quoi je faisais allusion : « Autrefois, on ne conspirait jamais que contre un ordre établi. Aujourd’hui, conspirer en sa faveur est un nouveau métier en grand développement. Sous la domination spectaculaire, on conspire pour la maintenir, et pour assurer ce qu’elle seule pourra appeler sa bonne marche. Cette conspiration fait partie de son fonctionnement même. » Et Debord d’ajouter plus loin : « Ainsi, mille complots en faveur de l’ordre établi s’enchevêtrent et se combattent un peu partout, avec l’imbrication toujours plus poussée des réseaux et des questions ou actions secrètes ; et leur processus d’intégration rapide à chaque branche de l’économie, la politique, la culture. La teneur du mélange en observateurs, en désinformateurs, en affaires spéciales, augmente continuellement dans toutes les zones de la vie sociale. Le complot général étant devenu si dense qu’il s’étale presque au grand jour [c’est moi qui souligne, MBK], chacune de ses branches peut commencer à gêner ou inquiéter l’autre (…) ». Toute ressemblance avec les politiques gouvernementales actuelles, avec la guerre numérique mondiale de l’information, ou avec les stratégies antagonistes des laboratoires pharmaceutiques véreux ne serait que pure coïncidence…
Passons-en, donc, et des meilleures. Par les temps qui courent, le temps soi-disant « réel » de l’information numérique, on n’en finirait pas. Nous sommes effectivement dans l’état d’exception tel que « prophétisé » par Agamben sur la base notamment de l’étude du national-socialisme allemand. Ce qui présage, comme chacun s’en doute, de lendemains qui chantent et jouent de la balalaïka.
Qu’est-ce que l’état d’exception ? Un état où le souverain seul décide de ce que doit être la règle civique. Mais, à mon humble avis, pour des raisons que j’analyserai ailleurs (j’entrerai ici un peu en matière), les nouvelles dictatures qui ont fait plus que se profiler depuis plus d’un an auront ceci de nouveau par rapport aux bonnes vieilles tyrannies : elles consisteront, comme on le voit à ciel ouvert, à changer tous les jours de règles civiques pour rendre la population folle (et je reparlerai de la question politico-esthétique de la « folie » : le nom d’Artaud, un autre grand nom de la contre-culture avec Debord, ne tombe pas par hasard dans le présent texte : je cite mes sources, moi, pas comme les médecins de plateaux télévisés).
Comme chacun sait encore, ce ne sont pas tant les hôpitaux « normaux » qui sont débordés par la « crise COVID » que les services psychiatriques, appelés à décupler de volume et d’effectifs dans les temps qui viennent si les choses suivent leur cours actuel. Comme l’avait aussi bien prophétisé Debord, ce qu’il appelait le « spectacle » c’est le Capital devenu fou, et la « science » officielle qui l’appointe aussi bien. Là encore, s’il doit y aller d’une quelconque « politique culturelle » dans l’époque monstrueuse où nous sommes entrés (monstrueuse comme jamais aucune époque ne l’aura été avant elle), c’est de ce constat littéralement clinique qu’il faut partir.
Je ne me fais plus aucune illusion sur l’issue éventuelle de la situation : s’il n’y a pas un soulèvement d’ampleur nationale, appelé à se propager en guerre civile mondiale réelle, eh bien, partout, l’état d’exception sera destiné à se perpétuer, en renouvelant à chaque nouvel effet les frais collatéraux, c’est-à-dire rien moins que le suicide assisté de la population, d’abord au ralenti, puis un peu plus vite. Certains, assez lucides, parlent déjà de troisième guerre mondiale ; moi, en mon nom propre en sans engager quoi que ce soit des autres membres du Gouv, je parlerais volontiers de première guerre civile mondiale de l’histoire de l’humanité.
Nous en sommes loin pour l’instant. Comme le prouvent les investissements effectifs de notre gouvernement officiel (partout, sauf dans la santé), les balles réelles en revanche ne sont plus très loin, et ce n’est plus à des mutilés « préventifs » (destinés à terroriser, déjà, la population) qu’on aura affaire, mais à des morts directs. Pour tout dire c’est ce à quoi nous assistons déjà : c’est moins le COVID qui tue que les « politiques » improvisées qui sont censées le contrecarrer, en pure perte semble-t-il.
Pour l’instant, c’est la technique de l’assassinat par procuration qui est à l’honneur ; c’est pourquoi, d’ores et déjà, nous ne devons pas compter les « suicidés de la société » que produit la politique gouvernementale présente pour des cas de pathologies contingentes ou de disruptions psychiatriques inexplicables, mais comme des soldats morts au combat (ma mère, par exemple, s’est pendue à cause du premier confinement ; salutation au passage au collectif des restaurateurs, « les pendus », quand les subventions cesseront de tomber…).
Jamais, peut-être, car à échelle mondiale, les vieux slogans du type « la révolution ou la mort » ou « la liberté ou la mort » n’auront été si pertinents, contre toutes les apparences du contraire. C’est-à-dire d’une gouvernance mondiale déchirée (les « complots enchevêtrés » de Debord) qui s’y entend seulement à administrer homéopathiquement la mort. Si nous laissons faire, ils n’hésiteront pas une seconde à forcer les doses.
Non, je ne suis pas un « ministre de la Culture ». Je déclare ce qui est déjà évident : la guerre civile mondiale.
Encore et toujours, si une « politique culturelle » ne prend pas en compte cet élément méta-exterminationniste où nous baignons tous depuis plus d’un an, je ne sais pas ce qu’elle peut bien valoir. Encore et toujours, l’issue politique de l’insurrection, au fond toujours en cours (c’est sa grande force) des Gilets jaunes, ne décidera pas seulement du destin de la France ; mais du monde entier.
Car si nous ne démontrons pas, à la face du monde entier, qu’une nouvelle démocratie est possible, les choses continueront à suivre leur cours actuel. Tel est le sens profond du mouvement des gilets jaunes, qui aura « ringardisé » définitivement à mes yeux le camp auquel j’appartiens conflictuellement depuis l’adolescence, celui de l’extrême-gauche et de l’ultra-gauche « classiques ». Debord un jour, Debord toujours (il m’aura sauvé la peau, celui-là, comme Artaud : je n’ai pas de politique culturelle plus loin que ça…) : « Partout se posera la même redoutable question, celle qui hante le monde depuis deux siècles : comment faire travailler les pauvres, là où l’illusion a déçu, et où la force s’est défaite ? »
Renouvelons donc le questionnement, il est plein d’intérêt, sur la base de la phrase qui précède : si une « politique culturelle » ne prend pas en compte cette simple question-là, c’est-à-dire la simple question de la lutte des classes dans l’esthétique (le plus grand artiste vivant selon moi s’appelle Antoine d’Agata et c’est un prolo ; comme l’étaient Rimbaud, Van Gogh ou Artaud) qui éclate au grand jour depuis plus d’un an au prétexte de la « santé » (on soigne les riches, on laisse crever les pauvres), depuis plus de deux siècles, je ne vois pas bien ce qu’elle peut faire. Il y aurait, là-dessus, beaucoup à dire. Je me contente de renvoyer à ce petit bouquin sorti il y a six ans, Artaud et la théorie du complot, que tout le monde peut lire facilement et qui pose une question elle-même bête comme chou : la culture, c’est-à-dire l’art, depuis plus de deux siècles, a-t-elle été faite par des bourgeois, ou par des prolétaires ? Cela se discute longuement (j’adore Baudelaire ou Flaubert, mais n’étaient-ce pas déjà des « collabos », à la différence de Verlaine ou Rimbaud ?). Je dis simplement : voilà ce que les Gilets jaunes peuvent représenter historiquement : une telle discussion.
Les gouvernements occidentaux actuels n’ont pas de telles finesses : c’est toute la culture et tous les arts qui doivent être désormais prolétarisés (le génial et regretté Bernard Stiegler l’avait prédit). Des mots qu’on entend aujourd’hui, comme « non-essentiel » et « inutiles », ne sont pas moins infâmes politiquement que ne l’était l’appellation « art dégénéré » dans les années 30. Ils le sont même, à mon humble avis, un peu plus.
Sur toutes ces bases déjà pesamment complexes, j’ai tout de suite fait part dans nos discussions de mes doutes quant à la pertinence de proposer une politique culturelle « positive » à la situation. La culture et les arts ont été, en un peu plus d’un an, euthanasiés, avec bien d’autres choses (les pauvres, les jeunes, les commerces « non-essentiels »…). Ils ne s’en relèveront pas de sitôt. Pour ne pas dire : jamais. L’écrasante majorité des artistes, terrorisés par la propagande médiatico-gouvernementale, n’a pas moufté. Par exemple, si je m’accorde pleinement aux propositions qui ont été faites, dans nos discussions, d’organiser les grands médias par la cotisation et la mutualisation, j’estime que nous sommes allés beaucoup trop loin dans le mensonge d’État depuis plus d’un an pour proposer, au préalable, autre chose que la destruction pure et simple de ces mass-médias détenus en France à 90% par les dix plus grandes fortunes de France. J’aurai simplement la pudeur de ne pas citer de noms. Et j’aurai aussi la pudeur de ne pas citer les noms de ceux qui les détiennent…
Comme l’a établi le classement mondial de la liberté de la presse en avril 2020, la France était positionnée derrière la Jamaïque, le Costa-Rica, l’Uruguay, le Suriname, le Cap Vert, la Namibie, la Lettonie, le Ghana, La Slovénie et la Slovaquie. Comme le disait l’autre plus grand artiste vivant (vous voyez bien que, de la politique culturelle, j’en fais), Jean-Luc Godard, dans je ne sais plus quel film : « les pauvres sauveront le monde. » Déjà, ils échappent au vaccin obligatoire. C’est un très bon signe du bouleversement qui est en train de nous arriver : nommément le Great Reset de Klaus Schwab que je surnomme, avec la plus grande tranquillité du monde, « la solution finale de Davos ». La « démocratie » ? Oui ! Mais… intégralement numérisée, avec le « vaccin » pour tous, tous les trois mois. Chacun chez soi, et Dieu (i.e. la technologie) pour tous : voilà l’affriolant avenir qu’on nous promet si nous ne nous reprenons pas un peu.
Pareil pour la question du patrimoine : ce n’est pas simplement ce qu’on entend par là au sens strict qui est gravement négligé (les églises, les châteaux, etc.), mais l’ensemble de la culture anthropologique comme telle. La cancel culture a de très beaux jours devant elle : c’est partout que l’amnésie culturelle sera désormais organisée. L’ordinateur pourra tout effacer ; comme toute conscience humaine prise au singulier, sa mémoire sera sélective. Et comme sa sélection est organisée par les génies du GAFAM, la sélection sera rude : comme le disent aussi bien Klaus Schwab que Laurent Alexandre, les Goebbels de la Silicon Valley : les pertes seront très lourdes, que voulez-vous, il faut garder le cœur sec pour qu’advienne l’Entité de Demain. Ici comme ailleurs, la situation est celle formulée par le même Godard : « Sauve qui peut (la vie) ».
Mon « programme culturel » à ce sujet ? Vous citer les phrases d’un philosophe que j’adore et qui m’influence beaucoup, Philippe Lacoue-Labarthe: « C’est dans une tension entre le « très ancien » (l’oublié) et le « neuf » ou le moderne (l’à venir) que nous nous sentons et savons exister. Nous ne croyons pas l’ancien liquidé ni le moderne périmé. » Voilà pour le « patrimoine ». Tout le contraire de la cancel culture, et de la fameuse « table rase » des révolutions tronquées d’hier. En une phrase comme en cent, ce qui me paraît justement nouveau dans l’insurrection (toujours en cours) des Gilets jaunes, c’est précisément… l’ancien. « L’identité culturelle » de la France n’est pas raciale, comme tentent de le faire accroire les idéologies d’extrême-droite à l’ancienne (aussi périmées, au fond, que les idéologies d’extrême-gauche), mais modale. La France, c’est la Révolution. La France, c’est la démocratie. Voilà ce que notre gouvernement actuel est en train de faire passer par pertes et profits. Les Gilets jaunes proposent, au fond, un nouveau type de « révolution conservatrice » : sauver la République et la Démocratie, au moment même où l’actuel gouvernement est en train, sciemment, de les faire couler par le fond. Au nom de quoi ? De l’Europe, c’est-à-dire de la « mondialisation » : de l’universalisme abstrait. De la « gouvernementalité » mondiale, dont personne ne sait qui sera en mesure de l’administrer (un président américain gâteux ? Un roquet français ? Un chinois anonyme ? Une machine ? Nul ne sait, même si certains, nommément les transhumanistes, feignent de savoir, comme en leur temps les nazis). Une chose est sûre : nous assistons à la naissance, technologiquement assistée, d’un nouveau totalitarisme, pire encore que tous ceux qui ont jusqu’ici existé. Si une « politique culturelle » ne tient pas compte de ce fait, etc.
Dans ce cadre néo-totalitaire, dis-je donc, il me paraît totalement naïf de croire qu’on peut proposer une politique culturelle « positive », mettons à la Malraux. Sous le joug de ce Vichy biopolitique, nous sommes dans la situation même de la résistance (le « Conseil national de la résistance », qui associait des gens de gauche comme de droite, a souvent été évoqué dans nos discussions ; à raison, car le Gouv lui ressemble foutrement). C’est l’occasion de saluer en passant le collectif « RéinfoCovid », véritable maquis biopolitique actif, et celles et ceux qui mériteront la médaille « Jean Moulin » quand nous serons sortis de ce cauchemar éveillé (si nous en sortons, ce qui n’est pas gagné) : le professeur Raoult, le professeur Perrone, le Dr Louis Fouché, Martine Wonner, Alexandre Henrion-Caude et quelques autres.
On ne peut pas proposer une politique culturelle proactive mais seulement réactive à la tyrannie présente. Et dans l’aphasie artistique qui nous accable depuis plus d’un an, c’est déjà beaucoup.
Je récapitule donc ici, pour le public du Gouv, les grandes lignes de ce que je propose en matière de politique culturelle, tirées elles-mêmes des points essentiels de ce que m’ont appris vingt années d’investigations philosophiques.
1. La transgression
Comme je le répète depuis longtemps dans mon travail, l’art moderne, depuis la césure de la Révolution française (depuis Sade et Goya), a été pour une grande part celui d’un héroïsme de la transgression. Sade donc, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, les impressionnistes, Van Gogh, Dada, les surréalistes, Bataille et Artaud, les lettristes et les situationnistes, Pasolini et les punks… la liste est interminable. Or, que nous arrive-t-il ? Je l’ai dit plus haut : à mon avis, une forme entièrement renouvelée de la dictature, qui consiste à changer tous les jours les règles du jeu de manière à rendre la population folle et donc impuissante. La marge de manœuvre est très étroite, dans cet État fasciste-policier de type nouveau. Il est déjà trop tard, et nous devons faire avec, en risquant s’il le faut nos peaux, pour qu’advienne quelque jour un mouvement de libération nationale.
Ici se pose, comme fonds philosophique de tout le problème, la question de ce que j’appelle dans mon travail « l’anarchie ». Ce mot recoupe chez moi trois sens distincts, et pourtant solidaires entre eux.
En premier, l’anarchie des anars, toutes tendances confondues (en ce qui nous concerne de plus près, je souscris entièrement aux propositionsde « municipalisme libertaire » de Jean-Pierre Crépin ainsi qu’au travail d’Étienne Chouard, l’intellectuel « organique » des Gilets jaunes depuis des années). Le principe anti-principiel (je précise plus loin ce que j’entends par cet oxymore) a été récapitulé par l’anarchiste américain Goodman : « L’anarchisme se fonde sur une proposition assez claire : qu’un comportement valable ne peut naître que de la relation directe d’individus ou de groupes volontaires aux circonstances que leur présente leur environnement historique. Il affirme que dans la plupart des affaires humaines, qu’elles soient politiques, économiques, militaires, religieuses, morales, pédagogiques ou culturelles, on fait plus de mal que de bien en utilisant la coercition, le commandement hiérarchique, l’autorité centrale, la bureaucratie, les prisons, la conscription, les États, la standardisation préétablie, la planification excessive, etc. Les anarchistes veulent accroître le fonctionnement intrinsèque et diminuer le pouvoir extrinsèque. »
Des communautés restreintes, par démocratie directe et délibération constante, créent elles-mêmes, au mépris des lois édictées par les États et les gouvernements, des règles de coexistence civique. Ici les artistes auront une tâche que je dirais « bioesthétique », contre la délirante biopolitique en place qui rend la vie tout simplement invivable, c’est-à-dire d’inventer ce qu’Agamben, encore lui, appelle des « formes de vie ». Mon interrogation par rapport à la fonction ministérielle dans le Gouv est peut-être que je suis trop anarchiste pour ne serait-ce que croire à une telle fonction. Pour dire toute la vérité, je crois que les seules politiques possiblement probes ne peuvent se faire qu’à l’échelle de quelques milliers de personnes tout au plus (les ZAD en sont un excellent exemple, et elles me tentent en ce moment beaucoup). Toutes les expériences anarchistes ou presque le confirment.
Cependant, trois exceptions d’ampleur me viennent à l’esprit : la Commune de Paris, menée essentiellement par des ouvriers anarchistes ; la Révolution espagnole des années trente ; et, et, et… les Gilets jaunes ! Je ne suis pas le seul à l’avoir remarqué, mais les Gilets jaunes auront fait penser à un début de révolution anarchiste à l’échelle nationale.
Je crois, par contre, avoir été le premier à signaler que les Gilets jaunes avaient porté au niveau populaire « l’action restreinte » des situationnistes (qui a, tout de même, donné mai 68). Les Gilets jaunes à mes yeux, c’est du situationnisme à grande échelle. Or, quel fut le geste des situationnistes par excellence ? Leur appellation l’annonce : « créer des situations ». Les ronds-points, ce fut de la création de situations à grande échelle. Le geste des situationnistes, ce fut cela : rendre la pratique artistique et la pratique politique indiscernables.J’ai d’ailleurs récemment préfacé une artiste anarchiste grecque, Georgia Sagri, dont le livre est édifiant sur ce qu’il en est du début de guerre civile en Europe dans son pays (là-bas les dissidents se font réellement assassiner, et, attendue la situation des droits de l’homme en France depuis l’investiture Macron, nous y allons tout droit aussi : vive l’Europe démocratique), et qui fait exactement cela.
En deuxième, c’est l’anarchie au sens d’un philosophe qui m’influence beaucoup, Reiner Schurmann (c’est lui qui m’a permis de comprendre que la question de la transgression était centrale) : ce qu’il appelle : « le principe d’anarchie » que Frédéric Lordon a récemment repris en parlant de « condition anarchique ». Qu’est-ce à dire ? Que nous vivons la première époque de l’ère anthropologique où une civilisation ne dispose plus de principe directeur univoque pour savoir comment penser et agir (vous avez dit « mondialisation » ? « transhumanisme » ?). Par exemple, les grecs avaient le principe de l’Un, les romains avaient le principe de la Nature, le moyen-âge avait le principe de Dieu, les modernes depuis Descartes avaient le principe de la conscience subjective (notamment « l’individu libéral », définitivement supprimé par la « crise » récente). Or, pour la première fois de notre histoire, nous ne disposons plus d’un tel principe (les transhumanistes, j’y reviendrai, croient pouvoir en proposer un). Le principe d’anarchie est donc l’oxymore du principe de l’absence de principe. Ca va avec ce qui précède : inventer des principes toujours temporaires, adéquats aux situations concrètes où l’on se trouve. C’est pourquoi les plus grands anthropologues (par exemple mon regretté et génial ami David Graeber) sont si souvent spontanément anarchistes : ils apprennent, en examinant de nombreuses tribus de chasseurs-cueilleurs, qu’il existe autant de principes qu’il existe de sociétés différentes. Les principes, il ne faut pas simplement en hériter, il faut les inventer, au cas par cas. C’est ça, l’anarchisme historique.
Nous entrons dans un monde extrêmement violent dont le réel est la guerre civile. Je ne peux pas être « ministre de la Culture » car je pense que désormais, il faut qu’il y ait autant de « cultures » qu’il y aura de sociétés dispersées, tribales (oui, le « survivalisme » n’est pas loin). Devant la dictature d’autant plus cruelle que désespérée qui essaye de se mettre en place, et n’aboutira qu’au chaos généralisé, nous avons d’ores et déjà besoin d’un néo-primitivisme de la culture. L’art promu par le Gouv en temps de « covidisme » doit avoir la forme d’un exorcisme collectif du régime terroriste qui nous est imposé depuis plus d’un an, et qui fait penser à la « grande terreur » stalinienne des années trente.
Ceci signifie aussi bien quelque chose d’immensément inquiétant, mais que je ne peux passer sous silence : l’absence époquale de principe signifie, comme je l’ai suggéré, que ceux qui détiennent le pouvoir macroscopique seront de plus en plus obligés d’improviser les lois de leur gouvernance. C’est ce à quoi, « covidisme » oblige, nous assistons déjà. Ceci fait penser à la phrase des bourreaux du Salo de Pasolini : « Les vrais anarchistes, c’est nous. » Par exemple, les libertariens sont de tels « anarchistes » ouvertement d’extrême-droite, qui prendront le pouvoir demain si nous ne faisons rien. Des fascistes mondialistes… Mais il suffit de voir la manière dont est menée la France en ce moment pour comprendre de quoi il s’agit. « L’extrême-centre est une extrême-droite parmi d’autres », disent des artistes taggeurs dont nous ferions bien de nous inspirer. Il n’y aura jamais de « retour au monde d’avant » et si nous laissons faire ce pouvoir criminel, mensonger et incompétent, c’est le pire qui est encore devant nous. Ils ne s’arrêteront pas en si bon chemin.
Pour résumer : contre le totalitarisme qui est en train de s’installer tranquillou et qui improvise ses « principes » à la va-comme-je-te-pousse (le COVID ! le vaccin ! le passeport vaccinal ! et chaque jour une nouvelle mesure démentielle…), il nous faut affirmer à chaque fois des principes créateurs ajustés à la situation collective où l’on est ici et maintenant. Voilà ce que je propose, et rien de plus, en matière de « politique culturelle » ajustée à notre temps.
Enfin, c’est une définition plus personnelle, fruit de longues lectures, que je donnerai ici de l’anarchie pour compléter le tableau. C’est que la philosophie moderne, depuis Kant, a consisté en un travail incessant, et très diversifié dans ses directions, de ce qu’on a fini par appeler la « déconstruction de la métaphysique ». C’est pourquoi je n’adhère pas aux discours en vogue qui nous disent en somme « c’est la faute à la déconstruction de Foucault, de Derrida ! » comme c’était déjà la faute à Voltaire ou à Rousseau. La déconstruction, c’est beaucoup plus profond que ça. C’est le mouvement de la philosophie moderne depuis Kant. Schopenhauer ne déconstruit pas la métaphysique comme le fera Marx, qui ne le fait pas pareil que Nietzsche, qui ne le fait pas pareil que Heidegger, qui ne le fait pas pareil que Foucault ou Derrida… et, moi-même, je ne déconstruis pas la métaphysique sur le même mode que ces gens-là. Mais essayons de résumer : c’est quoi, cette histoire de « déconstruction de la métaphysique » ?
La métaphysique, c’est l’histoire de la philosophie occidentale depuis Platon. C’est, tout simplement, la langue que nous parlons. Or, comment s’accomplit la métaphysique ? Heidegger répond, avec un génie anticipateur, par la technologie planétaire. Toutes les hypothèses formulées par la métaphysique s’accomplissent sous forme technologique. En s’accomplissant, elles ratent : par exemple, « l’homme maître et possesseur de la nature » de Descartes ; autre exemple frappant aujourd’hui, l’immortalitépromise dès son envoi par la métaphysique (nommément Platon) qui revient en force avec le transhumanisme. Le programme de Descartes s’est entièrement accompli, on sait avec quel résultat : le suicide de 90% de la biosphère. Et le « programme » des transhumanistes s’accomplira : quelques « immortels » qui seront des bêtes de foire de luxe, avec un désastre anthropologique généralisé à la clé.
Chacun mesurera donc à quel point le projet occidental (car la métaphysique est essentiellement occidentale) a réussi, c’est-à-dire mené la planète au bord de ce qu’on appelle aujourd’hui « l’effondrement » : le suicide planétaire, tout simplement (annoncé par les innombrables suicides individuels qui ont lieu en ce moment, sous le coup des mesures soi-disant « sanitaires »). Être un penseur moderne, c’est regarder en face cet effondrement. C’est pourquoi le transhumanisme ne propose rien qui n’ait été dit par la métaphysique, c’est-à-dire Platon : puisque l’homme est l’animal capable de science et de technologie, alors il est le seul animal capable d’immortalité (j’ai écrit un petit livre là-dessus, sobrement intitulé Dieu, dont il n’est pas à exclure qu’un Laurent Alexandre se soit inspiré, quoique bien sûr à contrepied).
C’est exactement le contraire que nous avons sous les yeux : le fait d’être des animaux technologiques précipite notre disparition prématurée de la planète, par rapport aux durées des autres animaux qui se comptent si souvent en millions d’années (sauf toutes celles que nous exterminons, bien sûr, que nous « suicidons » avec nous…). Le transhumanisme, comme le nazisme, est une religion de remplacement, qui ne durera pas beaucoup plus que le nazisme et commettra probablement autant d’horreurs qu’elle. Sinon beaucoup plus.
Passons aux aveux : c’est exactement ça que je crois avoir en ce moment sous les yeux. Je pense tous les jours depuis des années à une phrase terrible de Walter Benjamin, philosophe juif qui s’est suicidé pour échapper au nazisme : « la modernité doit se placer sous le signe du suicide ». L’État nous « suicide », tous autant que nous sommes. Comme les artistes sont en première ligne, qu’ils prennent les devants : qu’ils commettent des attentats-suicides symboliques qui transgressent les lois de l’état d’exception présent, juste le temps de ne pas se suicider pour de vrai. Désolé donc d’enfoncer le clou de ce que j’ai défendu dans nos discussions : ce sont les artistes eux-mêmes qui doivent enfoncer le clou de ce que Lalanne, Bigard, les masques blancs, les « Danser encore » n’ont fait qu’esquisser jusqu’ici. Se suicider symboliquement pour donner l’exemple, contre le suicide collectif que nous promet à mots à peine couverts le mondialisme devenu fou.
Voilà pour les trois sens du mot « anarchie ». Pourquoi entrer à ce point dans le détail ? Parce c’est en saisissant le lien qui unit ces trois définitions qu’on peut comprendre à quel point, en art et en politique (les deux étant, pour le conseiller culturel que je suis, presque inextricables désormais), la question de la transgression est importante.
La question que je juge centrale en philosophie est la suivante : l’animal humain est le seul à être susceptible de s’approprier les lois de la Nature et de l’être, c’est-à-dire susceptible de science et de technologie. Pourquoi, dès lors, est-il de plus en plus incapable de se fixer à lui-même des règles de coexistence civique à peu près vivables ? Pourquoi, comme on le voit désormais à tombeaux ouverts avec la « crise du COVID », les hégémonies politiques de quasiment tous les pays sont-elles de plus en plus amenées à décider de lois arbitraires, délirantes, criminelles, liberticides ? Qu’est-ce qui nous différencie encore de la Chine voire de la Corée du Nord ? Et pour combien de temps ?
Voilà pour la transgression. Proposition au Gouv : une alliance étroite entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice. Il faut que les artistes soient capables d’éprouver la Loi à sa limite. Voyez l’exemple récent de Piotr Pavlenski. Je donne souvent la suggestion suivante : dans le code civil, si vous attaquez une banque à quarante-neuf personnes, il s’agit d’un braquage. À partir de cinquante, il s’agit d’une émeute. Que se passerait-il si une association de cinquante artistes et intellectuels dotés d’un « capital symbolique » congru décidait de faire comme Piotr Pavlenski, et de brûler une banque ? Dans ma vidéo avec Jean-Pierre Crépin, je parle d’introduire par les artistes une guerre civile symbolique, qui soit, en quelque sorte, une catharsis de la guerre civile réelle qui nous attend inéluctablement si nous ne faisons rien.
2. Le jeu
Ça fait longtemps que je soutiens dans mon travail que le jeu, tous les jeux réellement existants (par exemple les sports, presque interdits par les temps qui courent…), doivent être considérés comme des catégories esthétiques, donc artistiques, à part entière. Les transgressions qu’il est désormais du devoir des artistes d’inventer dans chaque situation concrète où ils se trouvent doivent prendre la forme de jeux grandeur nature. « Créer des situations » au lieu de les subir.
C’est qu’à mes yeux le jeu a une étroite partie liée avec la question, aujourd’hui vitale, de la liberté. Pourquoi ? Pour commencer : parce que ce mot est entaché de plus d’une ambiguïté. C’est à lever cette ambiguïté qu’une importante partie de mon travail est consacrée. Car, de fait, la définition moderne de la liberté depuis Kant, ce n’est pas de « faire ce que l’on veut », c’est même le contraire. Il n’y a de liberté qu’humaine, car être libre c’est se soumettre à une règle qui ne se trouve pas dans la nature. Ça commence avec les tribus de chasseurs-cueilleurs et ça finit par les « lois » improvisées imposées par le fascisme spontanéiste des GAFAM, en passant par tous les « états d’exception » qui définissent désormaisà peu près tous les Etats planétaires existants (vive le Danemark ! Vive Lars von Trier !).
On retrouve la question centrale que je posais plus haut : pourquoi est-ce que, alors que nous sommes capables d’édicter à peu près toutes les lois de la nature (pour mieux l’exploiter, et c’est tout le problème…), n’avons-nous à ce jour pas trouvé de règles pérennes pour organiser notre vie en commun à grande échelle ?
La liberté, c’est donc la contrainte intériorisée, c’est le dressage. C’est la question de l’éducation, c’est-à-dire le dressage différé. La fermeture, sous ce rapport, des écoles, des lycées et des universités n’est pas de très bon augure : plus on efface les modalités de dressage civilisé, c’est-à-dire sophistiquées par la mémoire et le poids de la culture, plus les modes de dressage les plus archaïques risquent de revenir, et à la dure : la police, puis l’armée.
Pour Kant, encore pris dans l’idéologie de la conscience individuelle qui définit notre modernité finissante, la liberté, c’est de me donner une règle qui n’est pas inscrite dans la nature. Il ne voit pas que cette règle est toujours donnée du dehors, par autrui, et c’est pourquoi la question de la liberté ne peut se poser que collectivement. Généralement par monsieur Tapedur en personne. Par exemple : personne ne m’oblige factuellement à m’habiller pour sortir dehors. Ce sont mes parents qui me l’ont appris tout petit, et c’est cette règle intériorisée qui est devenue, comme on dit si bien, une « seconde nature » : aucune autre espèce que la nôtre ne pratiquant cette étrange coutume de l’habillage. Il n’empêche que, bien sûr, si je sors dans la rue dans mon plus simple appareil, je m’expose à de graves ennuis : l’asile ou la prison. Personne ne m’oblige nommément à me laver, à payer mes impôts, à travailler, etc. Notre vie est tissée de milliers et de milliers de règles de la sorte : de règles parfaitement arbitraires, mais qui nous permettent de coexister à peu près pacifiquement. C’est pourquoi, quand ces règles ne tiennent plus et que leur arbitraire se révèle absurde, comme en ce moment, la guerre n’est plus très loin. C’est ça, la liberté. Elle a donc un sens négatif. C’est nous qui mettons les oiseaux en cage. Charité bien ordonnée, semble-t-il, commence par soi-même…
C’est seulement sur cette base négative de la définition de la liberté que peut se poser la question d’une liberté positive. La Loi c’est, en amont, l’esclavage, la corvéabilité, et la pénibilité. C’est là-dessus que toutes nos « libertés positives » se sont enlevées.
Or, qu’est-ce qu’un jeu, n’importe quel jeu ? Un dispositif où, à point nommé, l’animal humain s’impose volontairement des règles arbitraires pour y trouver du plaisir. Telle est ma petite « découverte » philosophique : le jeu est le seul domaine anthropologique où la liberté négative telle que je viens de la définir se transforme, comme par enchantement, en positivité. Le jeu est le seul domaine où moi, l’animal humain perclus de règles intériorisées dont la plupart impliquent un fort taux de pénibilité (ne disons rien des « règles » totalitaires-improvisées actuelles), je prends tout à coup un plaisir intense à suivre une règle, de concert avec plusieurs de mes congénères : tous les jeux se jouant à plusieurs à l’exception du « solitaire ».
On saisit sans peine le lien avec la question de la transgression. Quand la liberté consiste à régresser vers son sens le plus étroit, celui de la seule contrainte, imposée en dernière instance par un homme seul (donc un tyran), quand ces contraintes se font de plus en plus nombreuses, absurdes, et mortifères, alors il faut aviser à créer, au nez et à la barbe de la police, réelle ou symbolique (les médias), de nouvelles règles de coexistence civique, fussent-elles parfaitement éphémères, le temps d’un événement ou d’une performance. Ce sera toujours ça de gagné. Comme le disait le camarade Gwen du comité citoyen de la Culture du Gouv : il s’agit de créer des « opérations coup de poing ». Je crois avoir d’ores et déjà fait plus que donner quelques pistes pour mener de telles opérations. Il s’agit simplement maintenant de les mener à bien.
3. La mort
Répétons-le une bonne fois pour toutes : on ne martyrise pas un peuple entier, jusqu’à sa jeunesse et ses enfants, au nom d’une maladie qui a 0,05% de taux de létalité (0,02% dans le monde…), sur des personnes elles-mêmes presque mortes. On ne tue pas les gens à petit feu à coup de décrets législatifs de plus en plus délirants, au nom de gens qui sont en somme déjà morts. C’est une parfaite absurdité, et c’est pourtant cette absurdité que chaque jour le système présent parvient à nous faire avaler. Allons plus loin, et proposons un slogan de politique culturelle qui frappe fort : plutôt crever du COVID que de ce système néofasciste. À l’heure où j’écris, on nous parle du « variant brésilien » pour perpétuer la propagande de terreur. Là, c’est 5% de morts, Tudieu ! Alors tenez-vous à carreau, soyez encore plus paranoïaques et reclus, ne rencontrez personne, suicidez-vous dans votre coin !
Assez de ces chiffres, de ces statistiques, de ces algorithmes : « moi, Antonin Artaud, je bous, je bous, et vous, critique, vous broutez mon bout dehors ». Quand bien même le sacro-saint COVID ferait autant de morts qu’Ebola (ce qui comme chacun sait n’est évidemment pas le cas), eh bien je sortirais de mon confort domestique paranoïaque, celui promis par le Great Reset – la solution finale de Davos – pour dire : « j’ai envie de vivre, même en crevant ».
Le présent système pousse les artistes au suicide, tout simplement. Au meurtre symbolique perpétré par le gouvernement sur les artistes depuis plus d’un an, a répondu une sorte de suicide symbolique de leur écrasante majorité (le silence terrifié), et parfois des passages à l’acte réel (l’immense claveciniste François Grenier, par exemple,sans aucun doute beaucoup de jeunes anonymes, et encore beaucoup d’autres qui viendront, à l’heure où j’écris le chiffre officiel des suicidés est curieusement dissimulé). Le mouvement des « masques blancs » a été l’une des rares ripostes artistiques, sous ce rapport, digne de ce nom dans la tyrannie présente : l’art depuis son origine (prépariétale, tragique…) a souvent consisté à mimer la mort. Les artistes doivent terroriser ce système qui nous terrorise, en montrant dans les jeux transgressifs à inventer séance tenante comment le présent système administre homéopathiquement la mort (par exemple, par le port absurde du masque en plein air).
Pour la note philosophique de la chose (comme vous l’aurez constaté, je ne peux m’en empêcher, et je ne sais si ça peut donner un bon « ministre de la Culture » au sens classique…) : je fais partie de ceux qui, disons depuis Hegel, auront essayé de penser différemment la mort. Qu’est-ce que mourir quand Dieu est mort, qu’est-ce que mourir quand il n’y a plus la consolation de l’immortalité à venir (et c’est là que la question des transhumanistes affleure) ?
C’est la définition liminaire que je donne de ce qu’on appelle le Mal : une augmentation absolument gratuite des souffrances simplement animales, celles liées aux besoins naturels, c’est-à-dire la sophistication de plus en plus extrême donnée aux moyens d’administrer la mort. Nous y sommes actuellement à plein. C’est pourquoi, depuis Sade et Goya, l’art moderne aura si souvent consisté à montrer le mal. Ce n’est pas être « sataniste » que de juger que, dans le système présent, c’est le Mal qui est au pouvoir, c’est-à-dire une manière inédite d’administrer la mort à plus ou moins petit feu. Je me souviens d’un film terrifiant sur les prisons australiennes qui s’appelait « Ghosts of the civil dead ». Nous en sommes, aujourd’hui, presque tous là, à part les 0,1% pour lesquels ce gouvernement agit réellement ; et les artistes un peu plus que les autres. Qu’ils montent en première ligne (il n’y a pas si longtemps, on appelait cela l’avant-garde) et montrent, par tous les moyens qu’il leur appartient d’inventer, comment c’est la mort qui nous gouverne au nom de la vie, la maladie au nom de la santé, la folie pure au nom de la raison.
4. La folie
Si je devais résumer mon travail philosophique par quelques slogans, je dirais volontiers : la transgression précède la législation. Le Mal précède le Bien. Et la folie précède la raison.
Ce ne sont que des slogans, qui comme tous slogans ne peuvent rendre raison de la complexité des problèmes auxquels ils renvoient.
Mais résumons la grande ligne : je réfute que, comme l’a dit la métaphysique, l’homme soit « l’animal rationnel ». Ce que je défends dans mon travail, c’est qu’il ne l’est qu’en second lieu. L’homme est d’abord l’animal fou. Il n’y a ni folie ni « rationalité » dans aucune autre des millions d’espèces animales qui ont peuplé cette planète : toutes ces espèces sont « rationnelles » en ce sens qu’elles obéissent au doigt et à l’œil à des règles qui leur préexistent, sans se les approprier. Nous, nous nous approprions ces règles, et cela s’appelle la science.
Or (c’est la question que je pose toujours), que penserions-nous en voyant un chimpanzé frotter deux silex ? Nous nous dirions que cet animal est fou. Voilà, illustré vite fait, le sens du fait qu’à mon sens la transgression précède la législation, la folie la raison, le Mal le Bien (nous avons d’abord exterminé les mammouths et les urés, et désormais 90% de la biosphère de la planète). L’art doit montrer ce fait : et c’est justement ce qu’il fait depuis Sade et Goya. Il est plus que temps de s’en rappeler, à l’époque exacte où c’est le pouvoir mondial qui est visiblement devenu fou. L’homme est l’animal fou : ni plus, ni moins. Artistes, montrez-le.
Pour finir, payons d’exemple : je vous envoie le lien pour un morceau de musique que j’ai réalisé au centre d’art Le confort Moderne, à Poitiers, avec mon ami Nicolas Jorio. Je m’y inspire des poètes qui m’ont le plus marqué, comme Lautréamont, Artaud ou Burroughs ; j’essaie, en effet, d’y tendre un miroir grossissant de la folie totalitaire qui s’empare en ce moment de nous ; la mort monstrueusement administrée, c’est-à-dire le Mal, y est abondamment illustrée. J’y transgresse, à ma mesure, quelques règles de bienséance discursive, par les temps de néo-censure terrifiante qui courent. Bref : j’ai fait ce que j’ai pu, pour le ministère de la Culture du Gouv. Bonne écoute exorciste !
https://www.confort-moderne.fr/fr/journal/detail/BIENVENUE/437